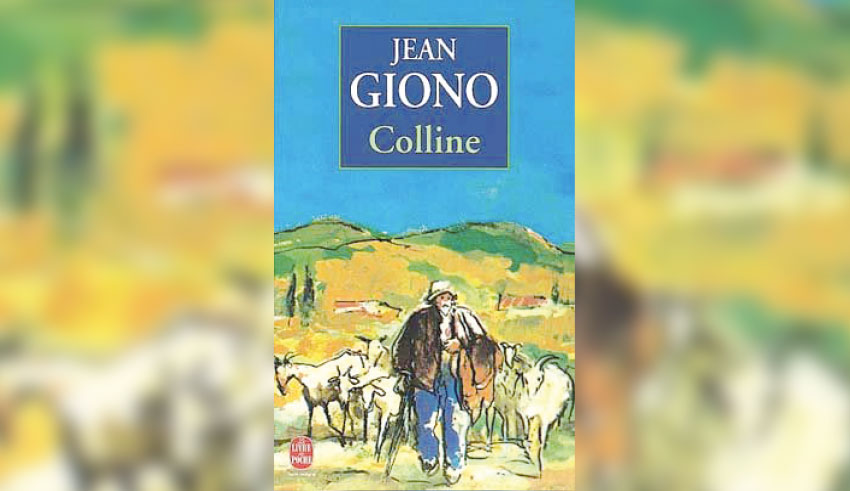
Les penseurs grecs, pour parler d’art, utilisaient volontiers la notion d’imitation : mimesis. Platon, évoquant le poète dans sa République, le compare à l’artisan. De la même façon, explique-t-il, que le menuisier se représente le modèle du lit en esprit pour le reproduire, pour en faire une copie matérielle, le poète se représente le monde, toutes les choses qui le peuplent – parmi lesquelles les héros de la mythologie qui sont des choses à leur manière -, et nous livre aussi une copie de ceci ou de cela.
Aristote, qui sur bien des questions avait coutume de prendre le contrepied de son maître, reprend pourtant la conception platonicienne. Plus que cela, il nous livre dans sa Poétique une théorie de la « mimesis » en guise de philosophie de l’art.

Se peut-il, pensons-nous, que les Grecs aient eu sur l’art une pensée si superficielle, eux qui nous ont étonnés par la profondeur de leurs méditations sur tant de sujets ? Qui parlerait aujourd’hui d’imitation à propos de création artistique ? L’art, sans même être abstrait, semble justement nous persuader qu’il n’est véritablement ce qu’il est que dans la mesure où il n’est pas imitation. Il est vrai qu’en matière de peinture, par exemple, nous avons assisté durant le siècle passé à une rupture avec le « réalisme ». Ce qui veut dire qu’avant ce mouvement d’insurrection, le peintre imitait en peignant. Toutefois, la réflexion sur l’art nous apprend que c’est dans une certaine déformation du réel que s’inscrit la démarche artistique. Ce qui fait la grandeur d’un portrait de Rembrandt, ce n’est pas qu’il ressemble en tout point au modèle, c’est au contraire cette sorte de violence heureuse qu’il inflige au visage. Il nous paraît d’ailleurs évident qu’une fidélité parfaite du portrait au modèle, qui le rapprocherait de la photographie, serait pour nous sans intérêt. Ce que nous disons apparaît mieux avec la caricature : n’est-elle pas une déformation du visage par accentuation outrancière des défauts ? Et pourtant, nous prenons plaisir à la regarder et nous y reconnaissons de la justesse. Ce qui nous surprend, c’est la vérité qu’elle révèle à la faveur de l’écart par rapport au réel. Il en est de même pour le portrait classique : sa force, et ce qui nous retient quand on le contemple, c’est ce qu’il fait ressortir grâce justement à ce léger décalage qu’il opère dans la reproduction du réel. Autrement dit, même quand l’art se place sous le signe de la mimesis, c’est plus pour la déjouer que pour la respecter qu’il s’accomplit. On s’en convainc encore plus lorsqu’on observe que même en aggravant l’écart — en passant du portrait de Rembrandt à celui de Van Gogh —, le constat reste le même. C’est sans doute ce qui a incité des artistes à pousser la logique à l’extrême en effaçant presque complètement le modèle. Ou en le raturant. Entreprise risquée, pas toujours réussie, mais entreprise utile pour permettre de pénétrer le secret de l’opération artistique. Elle est risquée car plus on détruit le modèle, moins on se donne la possibilité de jouer sur l’écart par rapport à lui. L’art cesse d’être connaissance de la chose à force d’occulter cette dernière. Or, tournant ainsi le dos au monde, de quoi va-t-il nous parler ? De rien ? De l’art lui-même, selon le mot d’ordre des poètes parnassiens qui revendiquaient « l’art pour l’art » ? Il y a de fortes chances que, dans ce « rien », ou dans « l’art pour l’art », il y ait l’artiste lui-même, qui se met à nous parler de lui et de son désordre intérieur. Et alors on a peut-être quitté le domaine de l’art pour celui de la psychanalyse. Ce qui est fâcheux car nous ne sommes pas tous ou ne voulons pas tous être des psychanalystes.
Une différence sémantique
Mais entreprise utile, car l’on apprend à travers elle qu’il y a bien une part de la vérité de l’artiste lui-même qui passe dans la vérité de ce qu’il nous donne à voir de la chose. La vérité que vise l’œuvre d’art n’est jamais indemne de cette contagion par la subjectivité de l’artiste. Mais là où ce phénomène serait jugé facteur d’altération ou de pollution de la vérité, à savoir dans le domaine des sciences objectives, il s’impose ici, au contraire, comme l’ingrédient essentiel sans lequel la vérité de l’œuvre ne saurait se manifester. En ce sens, Rembrandt ne se dévoile pas moins lui-même en peignant sa femme Saskia ou le personnage biblique de Bethsabée qu’en se peignant lui-même dans l’un de ces nombreux autoportraits. Voilà pourquoi, finalement, on considère que le concept de « mimesis » est inapproprié : il passe à côté de ce pouvoir de révélation propre à la subjectivité de l’artiste.
Ainsi, cela donne au moins deux motifs de contester la conception grecque : le premier parce que l’art s’affirme dans l’écart, plus que dans la soumission à la forme du modèle, et le second parce que la façon dont est reproduit le modèle est toujours en même temps l’expression de l’âme de l’artiste qui trouve dans le modèle une espèce de support. Il est certain qu’il y a là un paradoxe. Mais l’art en est le lieu : c’est nécessairement en se racontant lui-même que l’artiste nous dévoile la vérité de ce qu’il nous donne à voir ou à entendre.
Mais parce qu’on se méfie à juste titre d’une certaine propension de la pensée moderne à tirer gloire, parfois à trop bon compte, de ses conquêtes intellectuelles, il convient de revenir à un examen plus serré de la notion de mimesis, dans son acception grecque. Et commencer par prendre la mesure de la différence sémantique qui existe entre la notion grecque de mimesis et sa traduction par le mot français d’imitation.
Dans sa Poétique, Aristote nous donne une définition de la tragédie qui est la suivante : « La tragédie est l’imitation (mimesis) d’une action élevée, complète, ayant une certaine étendue […] imitation qui est faite par des personnages en action et non au moyen d’un récit et qui, suscitant pitié et frayeur, opère la purgation propre à pareilles émotions ». Première remarque : le thème de la purgation des émotions (de pitié et de frayeur), qui est connu de beaucoup d’entre nous sous sa dénomination grecque de « catharsis », renvoie plus particulièrement aux spectateurs de la tragédie. Dans un langage moderne, nous dirions que le spectateur « s’identifie » au héros tragique. Sans cette identification, il ne saurait éprouver les émotions dont le spectacle va lui permettre d’être purgé. Or l’identification est un processus psychologique qui relève lui-même de la mimesis. Il y a mimesis dans le travail de création poétique de la tragédie, et il y a aussi mimesis dans la façon dont le spectateur « se met dans la peau » du héros. Pourtant, il est évident que le spectateur ne reproduit pas, à proprement parler, un modèle. La mimesis est bien plutôt ce qui lui permet de s’installer dans l’action du drame, aux côtés, voire en lieu et place, du héros. Elle est ce qui le projette sur la scène pendant que son corps demeure installé sur les gradins.
Des mots ni familiers ni étrangers
Deuxième remarque : les personnages auxquels s’identifie le spectateur et qu’imite le poète tragique en les créant sont des personnages « en action ». Autrement dit, ce ne sont pas eux qui donnent à leur action le cachet qui est le leur, donc leur caractère « élevé » : c’est au contraire l’action — élevée — qui confère leurs traits aux personnages. Tous deux, le poète comme le spectateur, n’imitent le héros que dans l’exacte mesure où ce dernier est lui-même le théâtre d’une action. Laquelle action est noble, tout en suscitant la terreur et la pitié. La mimesis, ainsi comprise, transcende le modèle. A travers le personnage, elle vise une action qui ne se réduit pas à tel ou tel homme.
Ce point est confirmé par Aristote lorsqu’il en vient au chapitre 9 à comparer la poésie à l’histoire, en indiquant que cette dernière s’occupe de ce qui s’est passé tandis que la poésie s’occupe de ce qui pourrait se passer. La différence entre les deux est du particulier au général. Aristote poursuit en faisant observer qu’à ce titre la poésie est plus proche de la philosophie que l’histoire. A vrai dire, ce point mérite de faire l’objet de notre troisième remarque, parce qu’il souligne la présence de l’action à imiter hors du champ empirique. Cette action appartient à l’universalité de tout temps et de tout espace. Elle n’est pas tirée de l’expérience : elle la féconde ! Ce que le poète imite et propose à l’imitation au spectateur de la tragédie, c’est en somme quelque chose qu’il invente. Puisque l’expérience peut certes nous en suggérer l’idée, pas nous en livrer le modèle. Ce qu’il invente, c’est donc une action, dont Aristote nous dit qu’elle doit être parfaite en ce qu’elle doit avoir un début, un milieu et une fin, et que l’ensemble doit présenter une unité interne
On voit par là que l’écart sémantique entre mimesis et imitation n’est pas du tout négligeable. Il engage d’ailleurs le poète dans une utilisation du langage qui obéit à la double exigence de tirer une action du monde du possible et de la rendre suffisamment vraisemblable ou nécessaire pour que le spectateur s’y projette. Aristote, en outre, met en garde contre ce qu’on appelle le discours édifiant, qui transforme le poète en chantre de vertu. Il souligne à ce propos que pour répondre à la définition de poésie tragique, le discours peut se passer d’élévation des mœurs, mais pas d’unité de l’action. Il n’en reste pas moins que la tragédie tend à « imiter des êtres meilleurs que ceux de la réalité actuelle », comme il le mentionne dès le chapitre 2 dans la comparaison entre tragédie et comédie. Ou, plus précisément : à imiter des êtres qui, à la faveur de l’action, se découvrent à nous meilleurs que ceux que nous côtoyons au quotidien… Or, de la même manière que l’action imitée est aussi une action inventée, les mots pour la dire ne seront ni tout à fait familiers ni tout à fait étrangers. Aristote évoque ce sujet au chapitre 22 en nous parlant de la qualité de l’élocution. Cette dernière, écrit-il, est élevée lorsqu’elle s’écarte du « style vulgaire ». Puis, un peu plus loin, il précise : « le plus important, c’est d’avoir un langage métaphorique ; car c’est le seul mérite qu’on ne puisse emprunter à un autre et qui dénote un esprit naturellement bien doué ».
La bête et le feu
L’usage de la métaphore, nous dit Aristote, est ce qui s’accorde le plus au discours de la poésie tragique. La métaphore n’invente pas de nouveaux mots. En revanche, elle en modifie l’usage. Elle utilise un mot pour l’autre. C’est en cela qu’elle innove et c’est pour cela que nous disons qu’elle confère au langage un statut paradoxal de langage à la fois familier et étranger. A vrai dire, la poésie lyrique n’est pas moins concernée par cet usage de la métaphore. De même qu’on la retrouve dans la rhétorique. Aristote y revient d’ailleurs plus longuement dans son troisième livre consacré à cette matière.
On ne peut rendre la noblesse d’une action, dans ce qu’elle a de neuf et de surprenant, avec des mots qui appartiennent au langage ordinaire. Voilà ce que cherche à nous dire Aristote. Mais quand on en vient à examiner de plus près la métaphore, on se rend compte qu’elle déborde largement le champ particulier de la tragédie. La métaphore joue de certaines ressemblances entre les mots et, au-delà, entre les phrases, pour révéler un sens inattendu. Ces ressemblances n’apparaissent pas pour quiconque : il y faut « un esprit naturellement doué » ! Car il s’agit de ressemblances entre choses apparemment très dissemblables.
Prenons par exemple ce passage du roman de Jean Giono, Colline, qui raconte le spectacle d’un incendie de forêt et où il compare le feu à une bête sauvage : « La bête souple du feu a bondi d’entre les bruyères comme sonnaient les coups de trois heures du matin(…) Comme l’aube pointait, ils l’ont vue, plus robuste et plus joyeuse que jamais, qui tordait parmi les collines son large corps pareil à un torrent. C’était trop tard. » Le rapprochement entre la bête et le feu permet de restituer l’incendie dans le moment dramatique de son irruption d’abord, puis dans celui de la dévastation qu’il provoque dans les collines comme un loup ferait dans un troupeau de brebis. La comparaison est riche et va dans les deux sens : elle nous figure le feu d’une manière que nous n’imaginions pas et qui pourtant correspond à une vérité de la chose, et elle nous figure aussi la bête elle-même, dans le déchaînement implacable de son instinct destructeur, sous un jour inattendu. De sorte que chaque mot ouvre pour l’autre un espace de signification qui serait demeuré inconnu de nous si la métaphore ne les avait pas mis en liaison.
Il y a là une manière de tromper l’usage habituel des mots qui est essentiel à la pratique du langage poétique. Or elle repose elle aussi sur la mimesis : sur la capacité conférée au mot d’entrer en possession du « personnage » de l’autre mot. De son personnage « en action ». Ainsi, le travail mimétique s’accomplit chez le poète à un double niveau : celui des mots et celui de la scène… Ce faisant, il ne cède à aucune imitation passive et servile. Au contraire, si l’on en croit Aristote : puisque l’imitation du poète tragique, qui donne pour ainsi dire la mesure, nous projette sur la scène de l’action héroïque, par quoi il nous est donné de conquérir chaque fois un territoire nouveau de notre propre humanité… Sous le double signe de l’appropriation et de l’ascension !












